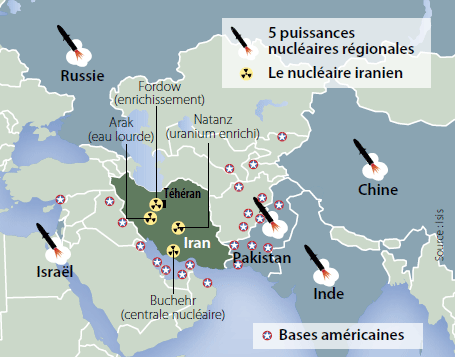Pour mieux comprendre la situation de ces animaux, un groupe de chercheurs brésiliens a lancé une étude, la première du genre à embrasser toute l’étendue de la forêt tropicale atlantique, visant à estimer la densité de la population des cinq espèces de cerfs présentes dans ce biome.
Dirigée par Márcio Leite de Oliveira, professeur à l’Université d’Araraquara et ancien postdoctorant au Centre de Recherche et de Conservation du Cerf de l’Université d’État de São Paulo à Jaboticabal, cette recherche monumental a nécessité plus d’une décennie de travail assidu pour aboutir à des résultats significatifs sur la densité des populations cervidées, une métrique cruciale pour la préservation de ces espèces.L’enquête a utilisé une méthode d’estimation de la densité qui comprend des échantillonnages de matières fécales à 31 différents points de 21 unités de conservation, couvrant la région nord-est au sud du Brésil.
Les excréments étaient situés par des chiens spécialement formés à cet effet, et l’analyse de l’ADN fécal a aidé à identifier les différentes espèces.
L’étude a révélé une corrélation alarmante entre les faibles densités de cerfs et les pressions anthropiques, notamment la chasse, la prédation par les chiens domestiques, les maladies transmises par le bétail et la compétition avec le sanglier, une espèce invasive qui consomme les mêmes ressources.
Les résultats, publiés dans le Journal of Applied Ecology, montrent que la densité la plus basse observée était de 0,14 individus par km² pour le cerf de Roe (Mazama Rufa) dans le parc national d’Araumarins, tandis que la plus élevée était de 18,17 cerfs rouges (Passalites nemorivagus) par km² dans la réserve biologique de Sooretama.Ce travail illustre clairement comment les influences humaines ont désormais un impact beaucoup plus significatif sur les populations de cerfs que les facteurs naturels tels que l’altitude ou la végétation.
Des données environnementales ont été collectées et une évaluation des menaces humaines a été effectuée sur chaque site, proposant des mesures de conservation adaptées.
Le nombre de gardes du parc, par exemple, s’est révélé être un facteur positif, influençant la densité des cerfs observée dans les zones protégées.
Ces découvertes fournissent des preuves solides qui pourraient orienter le futur de la gestion des aires protégées et la conservation des espèces de cerfs dans la forêt tropicale de l’Atlantique.
Ces estimations devraient être répétées tous les cinq à dix ans pour ajuster les stratégies de conservation aux conditions changeantes et aux nouvelles informations obtenues.