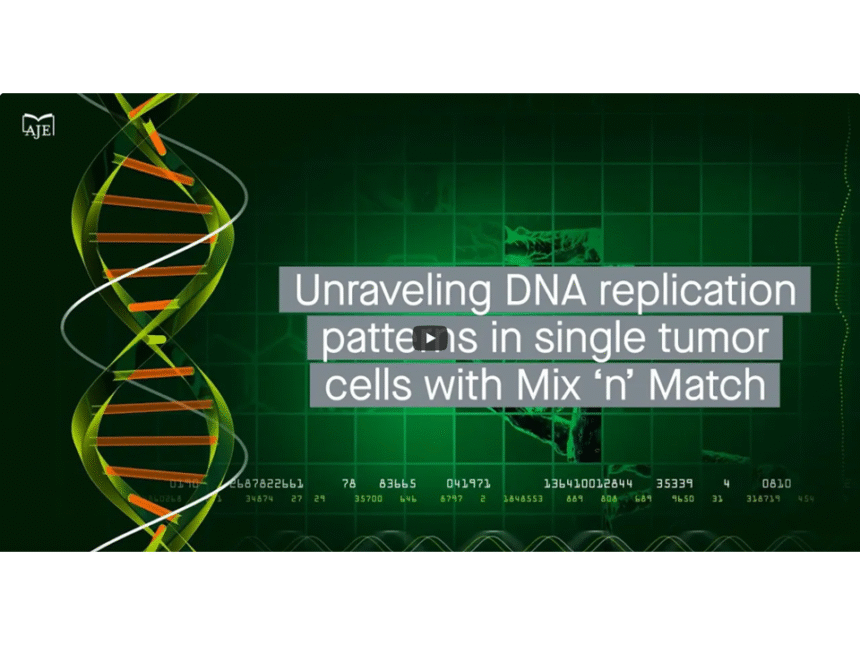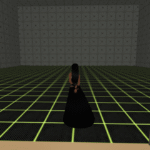Ce modèle avant-gardiste suggère que les microprotéines, bien que souvent négligées, sont localisées soit dans les endosomes, des organites dédiés au tri et à la distribution des molécules au sein de la cellule, soit dans les lysosomes, responsables de la dégradation et de l’élimination des déchets cellulaires.
Ce travail est réalisé par l’Institut Salk, qui contribue à redéfinir notre compréhension des microprotéines.
Historiquement, les protéines ont occupé une place prépondérante dans notre compréhension de la biologie.
Elles sont essentielles à la vie, jouant des rôles variés et complexes dans le corps.
Cependant, une sous-classe moins connue, appelée microprotéines, a longtemps été négligée, se retrouvant cachée dans les vastes étendues d’ADN souvent classées comme « non codantes ».
Malgré leur petite taille, limitée à moins de 150 acides aminés, leur potentiel biologique pourrait être tout aussi significatif que celui de protéines plus volumineuses.
Les chercheurs de l’Institut Salk s’engagent dans une quête pour explorer ces microprotéines, utilisant un nouvel outil d’analyse dénommé « arrêt-court » qui leur permet de naviguer dans des bases de données génomiques complexes afin d’identifier des segments d’ADN codant potentiellement ces microprotéines.
Cet outil innovant ne se contente pas d’identifier les microprotéines, mais il classe également celles qui sont susceptibles d’avoir une signification biologique, optimisant ainsi le processus de recherche et minimisant le temps et les ressources nécessaires.
Les résultats préliminaires des travaux menés par l’équipe de Salk sont encourageants : en examinant des données sur le cancer du poumon, ils ont découvert 210 nouvelles microprotéines candidates, dont une a été validée et pourrait jouer un rôle crucial dans le développement de futures stratégies thérapeutiques.
Comme l’explique Alan Saghatelian, professeur à l’Institut Salk, l’exploration de ces zones négligées du génome pourrait in fine éclairer notre compréhension de la santé humaine et des maladies.
Par ailleurs, la détection et la classification des microprotéines demeurent un défi en raison de leur taille.
Au lieu de leur recherche directe, les scientifiques se concentrent sur l’identification des petites cadres de lecture ouverte (SMORFs) au sein de l’ADN, lesquelles peuvent générer des microprotéines.
Les techniques actuelles, bien que prometteuses, sont souvent longues et coûteuses, compliquant la séparation entre microprotéines fonctionnelles et non fonctionnelles.
L’outil « arrêt-court » transforme ce processus.
En permettant une distinction entre les SMORFs qui conduisent à des microprotéines potentiellement actives et celles qui n’ont pas cet impact, il réduit considérablement la charge de travail expérimentale des chercheurs.
Enfin, cette nouvelle approche a déjà montré son efficacité en identifiant des microprotéines régulées dans les tissus tumoraux, pointant ainsi vers leur potentiel en tant que biomarqueurs pour des maladies telles que le cancer du poumon.
En intégrant des méthodes d’apprentissage automatique avec des ensembles de données disponibles, cette recherche ouvre la voie à une exploration large et détaillée des microprotéines, promettant des découvertes majeures qui pourraient transformer notre compréhension des pathologies, allant de l’Alzheimer à d’autres maladies métaboliques.