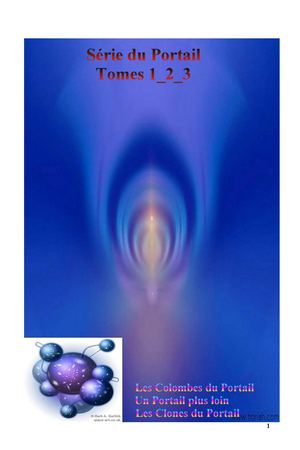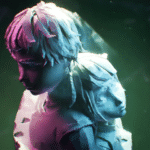Dans cette remarquable image capturée par le télescope spatial James Webb, on peut observer des galaxies lointaines éparpillées dans l’immensité du ciel nocturne.
Ces galaxies, souvent appelées "Little Red Dots" en raison de leur apparence, se manifestent sous forme de minuscules points rougeâtres.
Cette classification révèle les défis que posent ces objets mystérieux aux astrophysiciens.
Les astronomes du Centre d’Astrophysique de Harvard et Smithsonian ont récemment mis en avant une nouvelle théorie visant à expliquer la nature énigmatique de ces galaxies primitives.Dans une étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters, les chercheurs Fabio Pacucci et Abraham Loeb avancent l’hypothèse selon laquelle ces galaxies pourraient résulter de halos de matière noire ayant une rotation extrêmement lente, une configuration cosmique peu courante.
Ces petites galaxies, qui défient notre compréhension actuelle de la formation galactique et des trous noirs dans un univers ancien, semblent briller de manière inhabituelle en dépit de leur taille minuscule, atteignant seulement un dixième de celle des galaxies habituelles.
De plus, leur coloration rouge intense laisse à penser qu’elles pourraient être enveloppées de poussière ou peuplées d’étoiles plus anciennes.Cette recherche ne se limite pas simplement à explorer la composition de ces objets fascinants, mais s’attache aussi à comprendre comment ils ont pu se former dans un univers encore jeune.
Pacucci souligne que ces galaxies étaient probablement visibles à une époque où l’univers n’avait qu’un milliard d’années, durant ce que l’on appelle l’aube cosmique.
Bien que la lumière émanant de ces objets ait longtemps suscité des débats sur son origine—qu’elle provienne d’étoiles ou de trous noirs supermassifs—cette étude propose une approche distincte en se concentrant sur les conditions nécessaires à leur formation dans des halos de matière noire caractérisés par un spin très faible.
Ce phénomène explique non seulement leur rareté dans le vaste cosmos, mais aussi leur brève existence dans l’évolution de l’univers, suggérant que ces halos deviennent plus grands et plus rapides avec le temps, rendant ainsi difficile la formation de telles structures galactiques compactes.Cette investigation ouvre de nouvelles perspectives sur la compréhension des premiers trous noirs et de leur relation dynamique avec les galaxies qui les entourent.
Les observations actuelles, bien que fascinantes, continuent de poser de nombreuses questions.
Leurs résultats permettront d’approfondir notre connaissance des processus sous-jacents à l’émergence des premières structures de l’univers.
En somme, cette recherche représente une avancée significative dans l’exploration des premiers jours de notre cosmos.